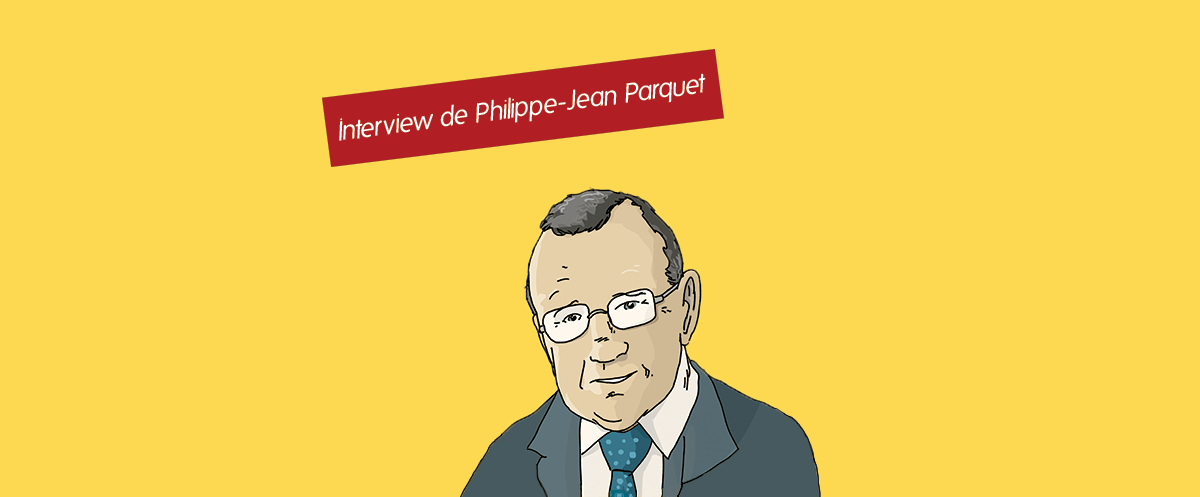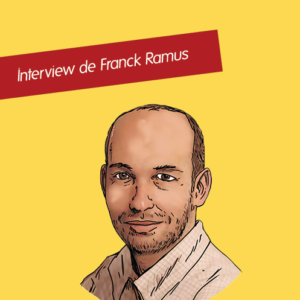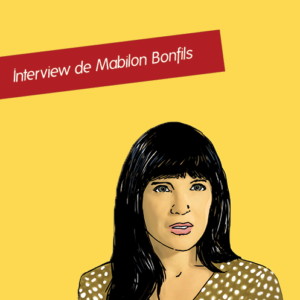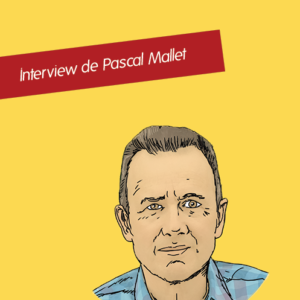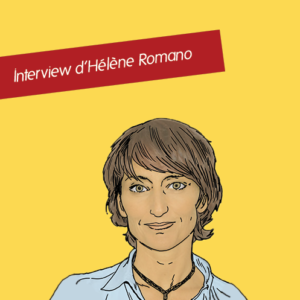Le 20 novembre aura lieu la Journée internationale des droits de l’enfant. Cette journée ne vise pas seulement à informer les enfants, les parents et les professionnels : elle invite aussi à ouvrir le dialogue et à rappeler que les droits de l’enfant doivent être connus, compris et vécus au quotidien.
Pourquoi ces droits sont-ils essentiels ? Comment les faire vivre dans la famille, à l’école ou dans les lieux de loisirs ou de temps libre ? Et à l’heure du numérique, comment accompagner les enfants dans un monde où leurs repères, leurs échanges et leur image se construisent aussi en ligne ?
Autant de questions que nous avons posées à Éric Delemar, Défenseur des enfants, adjoint de la Défenseure des droits, en charge de la défense et de la promotion des droits de l’enfant, et président des défenseurs des enfants au sein de l’association des médiateurs des pays de la francophonie.
Pourquoi les droits de l’enfant sont-ils essentiels ?
Les droits de l’enfant sont apparus tardivement dans l’histoire. Pendant longtemps, l’enfant n’était pas considéré comme une personne à part entière, mais avant tout comme un futur adulte à élever voire à dresser. Ce n’est qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, face aux souffrances vécues par des millions d’enfants, que les sociétés ont commencé à reconnaître les besoins d’attention, de protection et d’écoute des enfants.
En 1924, la Société des Nations adopte la Déclaration de Genève, inspirée par le pédagogue et médecin polonais Janusz Korczak, qui affirmait que la dignité et la liberté de l’enfant méritaient le même respect que celles des adultes. Ce texte marque la première étape vers une reconnaissance internationale des droits de l’enfant.
Plus tard, en 1959, l’Assemblée générale des Nations unies adopte une nouvelle Déclaration des droits de l’enfant, avant que la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ne soit signée en 1989, avec la France parmi les premiers pays à la ratifier.
Ces textes ont transformé notre regard sur l’enfance. Ils affirment que chaque enfant, où qu’il vive, a droit à la protection, à l’éducation, à la santé, mais aussi à la parole et au respect de son identité, et ainsi qu’il devient détenteur de l’ensemble des droits de l’Homme, dès sa naissance
Les droits de l’enfant sont donc essentiels car ils rappellent que les enfants ne sont pas seulement des êtres à protéger mais aussi des sujets de droits : ce sont des personnes dignes d’être écoutées, considérées comme des acteurs du monde dans lequel ils grandissent et dotées de réelles capacités de compréhension.
Comment les adultes peuvent-ils faire vivre ces droits ?
Faire vivre les droits de l’enfant, c’est d’abord considérer l’enfant comme une personne à part entière, avec sa dignité, ses besoins et sa parole. Cela demande à chaque adulte de porter un regard attentif sur l’enfant, dans tous les lieux où il grandit : à l’école, à la maison, dans les espaces de loisirs, de sport ou de culture.
Ces droits s’incarnent dans la façon dont on parle aux enfants, dont on les écoute, dont on organise les espaces qu’ils fréquentent. Ils concernent donc l’ensemble des adultes — parents, enseignants, éducateurs, animateurs, responsables associatifs ou de collectivité — qui partagent la responsabilité de leur protection, de leur éducation et de leur bien-être.
Faire vivre ces droits, c’est aussi favoriser un climat de confiance et de coopération entre tous les adultes qui accompagnent les enfants. En échangeant régulièrement, en partageant leurs observations et leurs questionnements, ces droits contribuent à construire un cadre commun, cohérent et rassurant. Ce cadre donne à l’enfant la certitude qu’il sera entendu, respecté et pris en considération, quel que soit l’endroit où il se trouve.
Mais faire vivre les droits de l’enfant, c’est aussi les lui faire connaître. Les enfants doivent savoir qu’ils ont les mêmes droits que les adultes : celui d’être protégés, respectés, écoutés et pris au sérieux. Leur rappeler qu’ils peuvent demander de l’aide — auprès de leurs parents, leur école, de la protection de l’enfance, d’une association ou d’un professionnel —, c’est leur donner la confiance nécessaire pour parler quand quelque chose ne va pas, c’est leur donner le courage de prendre la parole, et de s’assurer que s’ils se trompent ils ne seront ni moqués ni humiliés
“Petit être humain ne veut pas dire petit droit” : transmettre cette culture, c’est donner aux enfants les moyens de connaître et de faire respecter leurs droits et ainsi les moyens de comprendre le monde dans lequel ils grandissent.
Comment entretenir un dialogue avec les enfants, autour des droits de l’enfant ?
Entretenir un dialogue avec les enfants, c’est d’abord leur accorder du temps et de l’attention. Le dialogue se nourrit d’actions simples : poser des questions, écouter leurs réponses sans les interrompre, reformuler ce qu’ils disent pour leur montrer qu’ils ont été compris. Ces petites habitudes, répétées au quotidien, permettent à l’enfant de se sentir entendu et reconnu.
Il est important, dans cette relation de confiance, d’oser parler avec les enfants de ce qu’ils perçoivent du monde. Très tôt, ils observent et s’interrogent sur les sujets de société qui les entourent : la justice, l’amitié, les inégalités, la différence, … Leur en parler, c’est reconnaître qu’ils sont capables de comprendre et de réfléchir. Leur donner la parole, c’est leur apprendre qu’ils ont aussi un point de vue, et qu’il mérite d’être entendu. Ces échanges nourrissent leur réflexion, les aident à mettre du sens sur ce qu’ils voient et à se construire.
Ce dialogue s’enrichit grâce à tous les adultes qui entourent les enfants. Les parents ont naturellement un rôle essentiel dans cette relation de confiance, mais ils ne sont pas seuls : les professionnels de l’éducation ont aussi ce rôle — enseignants, éducateurs, animateurs, personnels de santé. Ensemble, ils accompagnent les enfants dans leurs apprentissages, leurs émotions et leurs découvertes, et soutiennent les parents dans la façon d’aborder certains sujets. Ce lien de coopération, fondé sur l’écoute mutuelle et la bienveillance, crée une continuité entre les différents lieux de vie de l’enfant et renforce son sentiment de sécurité.
Enfin, ce cadre de dialogue régulier permet à l’enfant d’exprimer plus librement ses émotions et de demander de l’aide s’il en a besoin. Lorsqu’un enfant se sent écouté et pris au sérieux, il ose dire quand quelque chose le met mal à l’aise ou l’inquiète, qu’il s’agisse d’une moquerie, d’une peur ou d’une situation de harcèlement. C’est une manière concrète de faire vivre ses droits dès le plus jeune âge, en lui montrant que sa parole compte et qu’elle sera toujours accueillie avec respect et bienveillance.
Quel impact a eu l’avènement du numérique sur la vie, et les droits des enfants ?
L’irruption et l’omniprésence du numérique dès la naissance de l’enfant modifie profondément les rapports entre individus, leur manière de s’informer, de communiquer et de se représenter aux yeux des autres. Les enfants d’aujourd’hui sont nés avec les réseaux sociaux, pour la première fois dans l’histoire les relations humaines sont challengées par les relations numériques. C’est un enjeu sociétal majeur, comme le souligne la CNIL, car le numérique est désormais un espace en soi, dans lequel les enfants grandissent, explorent, apprennent, mais aussi s’exposent dangereusement.
C’est aussi un espace commun, où se mêlent la vie personnelle et la vie publique. Y partager des images ou des informations qui relèvent de l’intimité n’est pas toujours anodin. Les adultes — parents comme professionnels — doivent donc être sensibilisés à ces enjeux, afin d’accompagner les enfants dans leurs usages du numérique et notamment des réseaux sociaux et de les aider à comprendre ce qu’ils publient, regardent ou commentent.
Les droits de l’enfant dans l’espace numérique progressent, mais lentement. La question du consentement des enfants et des adolescents devient centrale : savoir dire oui ou non à la diffusion d’une photo, à la création d’un compte, à la collecte de leurs données. Lors d’une de mes rencontres avec des enfants, une petite fille de 8 ans m’a demandé de dire à ses parents d’arrêter de diffuser des photos d’elle en vacances sur WhatsApp. Ce simple témoignage rappelle que les enfants eux-mêmes ressentent le besoin d’être protégés et respectés dans leur image et leur vie privée.
Mais le numérique, c’est aussi un canal par lequel les enfants découvrent le monde, parfois brutalement. Les guerres, les catastrophes climatiques ou les injustices leur parviennent désormais sans filtre, à travers des images ou des récits qui peuvent les troubler. Les enfants perçoivent et ressentent beaucoup plus qu’on ne le croit : ils peuvent être touchés, inquiets, ou même en colère face à ce qu’ils voient.
Le rôle des adultes est d’accompagner ces prises de conscience, en ouvrant le dialogue avec les enfants sur leurs pratiques en ligne : ce qu’ils y font, ce qu’ils y voient, ce qu’ils y ressentent. Ce dialogue est la première étape de la protection et de la prévention. Il permet d’aborder les risques — moqueries, harcèlement, exposition — tout en donnant aux enfants les moyens de comprendre leurs droits et de les faire respecter.
Enfin, l’école et les accueils périscolaires ont un rôle déterminant : ils contribuent à construire et animer ce dialogue autour du numérique, en aidant les enfants à développer un regard critique et responsable sur cet espace qui fait désormais partie intégrante de leur vie.
Quelles difficultés freinent encore la mise en œuvre des droits ?
Plus de trente ans après son adoption, la Convention internationale des droits de l’enfant reste une référence essentielle. Ratifiée en 1989 par 196 États, elle a profondément changé le regard porté sur l’enfance : elle reconnaît chaque enfant comme un sujet de droits. Pourtant, sa mise en œuvre demeure incomplète, y compris en France, alors que ses principes sont d’application supranationale.
La première difficulté tient à la méconnaissance des droits de l’enfant, chez les adultes comme chez les professionnels. Sans cette culture partagée, il est difficile de faire vivre au quotidien les principes de la Convention, que ce soit à l’école, dans les familles ou dans les institutions.
Viennent ensuite les inégalités sociales et territoriales, qui privent encore certains enfants de leurs droits fondamentaux : se nourrir, être soigné, aller à l’école, se loger dans des conditions dignes. Ces réalités rappellent que la pauvreté est aussi une atteinte directe aux droits de l’enfant.
D’autres freins tiennent au manque d’écoute réelle accordée aux enfants. Leur parole est parfois sollicitée, mais pas toujours prise en compte dans les décisions qui les concernent. Leur permettre d’exprimer leurs besoins, leurs avis et leurs inquiétudes est pourtant une condition essentielle pour construire des politiques publiques adaptées.
Enfin, il est essentiel de rappeler que les enfants et leurs familles ne sont pas seuls. Ils peuvent être écoutés, protégés et accompagnés par les services de protection de l’enfance, les établissements scolaires, les associations ou encore les professionnels de santé et du social. Ces relais jouent un rôle clé pour rendre effectifs les droits au quotidien. C’est ce que l’on appelle le soutien à la parentalité.
Et si des freins persistent, les avancées récentes montrent que les choses évoluent : la parole des enfants est mieux entendue, la sensibilisation progresse, les adultes s’engagent de plus en plus pour leur offrir un cadre de vie digne et protecteur. Faire vivre les droits de l’enfant, c’est un travail collectif et continu, à la fois exigeant et porteur d’espoir.
Pour aller plus loin
- Les études et rapports des Défenseurs des droits : ici
- Le programme JADE (Jeunes Ambassadeurs des Droits), qui est un dispositif d’éducation des jeunes à leurs droits par leurs pairs : ici
- Le programme Educadroit, qui propose des ressources pédagogiques en libre accès pour comprendre le droit : ici
Contacts utiles
Le Défenseur des droits peut être saisi directement et gratuitement par les victimes, témoins, associations, autorités publiques.
Plusieurs possibilités existent pour saisir le Défenseur des droits (à retrouver sur leur site) :
- Par formulaire en ligne
- Par courrier gratuit, sans affranchissement
- En contactant un.e délégué.e
Il est également possible d’obtenir des informations par téléphone :
- 09 69 39 00 00 (générale) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 (coût d’un appel local)
- 31 41 (personnes détenues) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 (appel gratuit – téléphonie sociale)
Toute personne qui pense être victime de discrimination peut appeler le 39 28 ou se rendre sur www.antidiscriminations.fr